|
|
Oeuvres de Lonergan |
|
|
|
Oeuvres de Lonergan |
|
|
Une entrevue avec Bernard Lonergan Intervieweurs : Eileen de Neeve, Stan Machnik
E.dN. : Bienvenue à cette séance spéciale de notre cours, « Affecting Good in History », Partie III, The Dynamic in the course of action. Nous souhaitons la bienvenue spécialement au père Bernard Lonergan. Le professeur Lonergan n’a pas besoin de présentations pour les participants de notre cours. Il est surtout connu pour ses grands ouvrages Insight. A Study of Human Understanding et Method in Theology. Le professeur Lonergan est à Montréal présentement pour le lancement d’un recueil de ses écrits en français1 et pour compléter une série d’entrevues qui doivent être publiés dans les TMI Papers l’an prochain2 et, troisièmement, ce qui nous importe le plus ici, il est venu enrichir notre compréhension de ses Essays on Circulation Analysis en particulier, et des enjeux abordés dans notre cours, « Affecting Good in History » en général. L’entrevue sera suivie d’une période de questions. Les animateurs du cours, les participants et les invités pourront poser des questions s’ils le désirent. S.M. : Il a été convenu que je poserais la première question, père Lonergan, et la question que je veux vous poser est : « Pourquoi devrions-nous étudier l’économie? » Nous avons quelque idée de la raison pour laquelle nous devrions étudier la philosophie, ou la psychologie, mais, vous savez, il y a peu d’économistes parmi nous. Et pourtant, en lisant votre livre, le lecteur peut déjà saisir que pour vraiment comprendre les choses il faut s’y plonger résolument. Comment en êtes-vous venu à vous plonger dans ces choses? B.L. : Eh bien, j’étais intrigué! J’étais en Angleterre de 1926 à 1930. Un professeur d’éthique avait publié un livre sur le capitalisme et la moralité, mais à l’époque ce sujet n’était pas accepté. On croyait encore à la loi d’airain de l’économie qui a eu cours pendant la grande dépression, jusqu’à l’affirmation de Keynes, selon laquelle l’économie est un enjeu moral, une science morale. C’est cela qu’il voulait signifier quand il parlait de « la question ultérieure ». Mais au moins il a soulevé l’idée qu’il fallait faire appel à l’introspection et au soma. C’était une science humaine du moins. Il y a trois choses qui m’ont frappé à mon retour au Canada en 1930. Premièrement, les pauvres n’avaient pas d’emploi et les riches, beaucoup de riches vendaient des pomme dans la rue, et il y avait des théories économiques qui flottaient dans l’air, des spéculations. La théorie dominante était celle du major Douglas, qui avait étudié les coûts de diverses choses qui étaient vendues sur le marché comme biens de consommation, et les sommes d’argent que les gens pouvaient gagner. Il n’y avait pas de proportion entre ces coûts et ces revenus. Il devait donc y avoir un manque de demande effective. Et il y avait une solution. Keynes avait la même idée, l’absence d’une demande effective, le chômage involontaire et ainsi de suite. S’il y a des emplois pour tout le monde, il n’y a pas de chômage. S’il n’y a pas assez d’emplois, s’il y a plus de gens que d’emplois disponibles, il y a du chômage. La solution est très simple, mais très différente de l’analyse marginale. Nous n’entrerons pas là-dedans. Je me suis donc mis à m’intéresser aux théories. La faiblesse de la solution de Douglas, soit que les banques donnent 25 $ à chaque foyer chaque mois, comme supplément de revenu, tenait à son caractère tout à fait inflationniste. Les banques ne peuvent faire cela. Keynes, lui, soutenait que si une économie souffrait du chômage sans espoir de l’éliminer, le gouvernement devait créer des emplois en ayant recours à un budget déficitaire, de la même façon qu’en période de guerre les gouvernements créaient de nouveaux types d’emplois grâce à des budgets déficitaires, par l’émission d’obligations et d’autres mesures, et cette idée a eu de plus en plus de succès notamment en Angleterre et aux États-Unis depuis. Les déficits sont énormes. Le pourcentage du produit national brut investi au Japon est de 45 %, selon un livre que j’ai vu. En Allemagne, le taux est de 35 % environ, en France, d’environ 23 %, aux États-Unis, d’environ 3 % et en Angleterre, d’environ 2 %. Ce sont des chiffres approximatifs. Il faudrait ajouter des décimales. Mais pourquoi les États-Unis et l’Angleterre sont-ils si loin derrière les autres? Eh bien, ils ont leurs programmes sociaux! Et les programmes sociaux ne permettent pas aux gens d’acheter au-delà de leurs moyens. Ils limitent les besoins. E.dN. : Vous mentionnez dans Circulation Analysis que l’État-providence est une aberration. B.L. : Bien, Il est nécessaire, selon les circonstances. E.dN. : Oui, OK. B.L. : Mais L’État-providence n’a pas le dynamisme des autres formes d’économie. Nous devons revenir à l’État stationnaire. Mais un État stationnaire ne signifie pas que nous produisions sous le niveau de notre capacité. Il signifie que nous produisons au-delà de notre capacité actuelle. S.M. : Le non-investissement, alors, c’est comme engendrer une condition stationnaire, ou peut-être une détérioration des… B.L. : La détérioration est une autre question. Mais l’État stationnaire signifie une économie qui continue indéfiniment de faire la même chose. L’économie des Physiocrates était stationnaire. L’élément clé était le surplus produit par l’agriculture, qui répondait aux besoins des gens pour l’année à venir. Il fallait avoir ce surplus provenant de l’année précédente pour les besoins de l’année courante. Et il fallait que cela se répète, tout simplement. Ils distinguaient différentes classes de gens et la façon dont ils se soutenaient entre eux. S.M. : Vous dites ailleurs qu’une véritable réflexion économique comporte une dimension éthique, que l’on ne peut séparer économie et éthique. B.L. : Vous ne pouvez séparer les règles pour la conduite d’une voiture de la façon dont le véhicule est construit. Vous pouvez dire à quelqu’un qu’il est fou d’appuyer sur les freins et l’accélérateur en même temps, et la plupart des gens vous croiront. Lorsque vous avez ce genre de préceptes dans votre économie, vous devez les faire analyser selon l’analogie d’un système pour pouvoir tirer des conclusions comme celles dont nous avons parlé. C’est de cette façon que vous pouvez élaborer des préceptes économiques qui peuvent être mis en œuvre sans problème, parce qu’ils permettent aux mécanismes de mieux fonctionner. S.M. : Alors il y a… B.L. : Il est bon que l’économie intègre la moralité. Mais vous devez connaître la science économique d’abord. S.M. : Et c’est dans cette direction que vous nous menez quand vous nous menez vers une compréhension des vélocités et des flux circulatoires, et des périodes de base et de surplus. Nous avons quelques difficultés à en comprendre le langage, et en parlant avec vous juste avant cette session vous nous avez dit qu’il était important de s’écarter du statique et de se concentrer sur les vélocités et les accélérations. Pouvez-vous nous présenter brièvement l’histoire des points de vue que les économistes ont adoptés et les idées avec lesquelles vous êtes fortement en désaccord. B.L. : L’économie accuse une faiblesse : elle peut se satisfaire de catégories descriptives, tout comme les gens se satisfaisaient jadis d’une science botanique qui se fondait sur les descriptions. Après Darwin, la botanique s’est centrée de plus en plus sur l’explication : d’où vient telle fleur, quels sont ses antécédents. Et de même en ce qui concerne les espèces d’arbres, d’animaux et ainsi de suite. Et la compréhension a progressé récemment avec la découverte de la double hélice dans les chromosomes. Mais la dynamique tient à la question morale : que devons-nous faire à ce sujet? Et pour savoir ce qu’il faut faire, vous devez savoir avec quoi vous avez travaillé, et ce facteur doit être quelque chose qui fonctionne. Autrement, vous ne saurez pas avec quoi vous travaillez. Une vélocité est un niveau de vie. C’est tant par année. Chacun, chacune a besoin de tant par année. Il ne s’agit pas d’une notion étrange. Une accélération est une nouvelle vélocité qui accroît d’autres vélocités. Le coton a été transformé, la production de biens en coton a été transformée lorsqu’on a introduit l’égreneuse de coton pour le nettoyer. Il ne s’agissait pas de laver le coton, mais d’en enlever les matières étrangères. Les excavatrices, qui déplaçaient la terre, en retiraient le minerai de fer et le charbon, le charbon pour le chauffage des fournaises et le minerai de fer pour obtenir la fonte brute. Les aciéries transformaient le fer en acier et les machines-outils fabriquaient la série d’instruments dont avait besoin l’industrie du coton! Des broches pour fabriquer des fils avec le coton nettoyé, des métiers à tisser pour transformer les fils en tissus et des machines à coudre pour transformer les tissus en vêtements. Et lorsque vous aviez ces moyens plus éloignés, plus sophistiqués, de fabriquer des biens en coton, le volume a augmenté considérablement et le commerce du coton a été le premier secteur qui a produit le grand essor en Angleterre. Et, lorsqu’un nouvel essor commence, il y a un peu de dépression parce que les choses existantes sont vendues à rabais et que la nouvelle chose n’a pas commencé à se vendre. E.dN. : Pourquoi les choses existantes sont-elles vendues à rabais? B.L. : Les gens ne comptent plus sur les anciennes façons… E.dN. : Les fouets de cheval… et… B.L. : Oui. Tout ce qui… S.M. : Si vous pouviez poursuivre dans cet ordre d’idées pour montrer que les vélocités sont les taux de consommation des ménages et que le changement de ces vélocités est l’accélération, vous avez décrit un changement de ces vélocités produit par l’invention d’outils et la fabrication de ces machineries. Mais où constatez-vous que vos insights, vos perceptions, ont été pour ainsi dire ignorées, n’ont pas été opératoires dans la théorie économique? B.L. : Au lieu de parler de revenus de base et de revenus de surplus, de vélocité et d’accélération, vous parlez de salaires et de profits. Vous employez deux grandes notions comptables que tout le monde peut comprendre. Ces notions n’ont aucune implication sauf des implications sociales. Vous pouvez déclencher une lutte des classes sur cette base. Or les implications économiques sont une affaire de vélocité et d’accélération. Et elles transforment, elles déterminent votre processus d’échanges. E.dN. : Pour poursuivre à propos de la terminologie, lorsque vous employez l’expression « expansion de surplus », ou « phase de surplus », et qu’il y a une phase de base, est-ce la même chose que l’investissement et la consommation ou non? B.L. : Il doit y avoir un rapport avec l’investissement et la consommation. Le surplus a également à voir avec le maintien de l’équipement actuel. Mais il s’agit de maintenir la vélocité actuelle, n’est-ce pas? Empêcher une chute de la vélocité. Le terme « surplus » existait chez les Physiocrates avant la révolution industrielle. Marx l’a employé en un sens différent. Il voulait parler des salaires des travailleurs et du reste de la valeur de leur travail que les capitalistes s’appropriaient. L’exploitation. Je préfère revenir au sens original du terme surplus puisque c’est clair comme la simple désignation des sentiments et de la pensée. E.dN. : Vous dites donc que le surplus est… B.L. : Plus que ce vous possédez actuellement. C’est ce qui représente la croissance de l’économie. Mais si vous avez une économie croissante, vous avez besoin de plus que du surplus, vous avez besoin d’un certain niveau de surplus, un niveau supérieur à celui du maintien. E.dN. : Ce surplus sert donc à maintenir vos moyens de production. B.L. : Oui. Et à les augmenter. E.dN. : Et c’est l’augmentation. S.M. : Vous parlez d’un rapport de point à point dans la phase de base, et de point à ligne, ou de point à surface, et d’autres rapports, dans la phase de surplus. Est-ce que j’ai raison? B.L. : Hmmm. S.M. : Pourquoi y a-t-il des cycles qui caractérisent le processus? B.L. : C’est un saut en avant. Le rapport point à point est celui du cordonnier. Quand il fabrique un soulier, il vend un soulier. Mais si vous avez une manufacture de souliers, vous avez un flux de souliers. Et le surplus qui construit les manufactures vous donne un flux de manufactures et par conséquent un flux de flux de souliers. Et quand vous obtenez un flux à partir de la première situation, vous avez d’abord une vélocité. Quand vous obtenez un flux de flux vous avez un accélérateur. À un niveau supérieur, vous avez un type supérieur d’accélération, qui s’étend. Ces différences se reflètent dans les paiements versés pour la réalisation du processus et c’est dans les paiements et le passage de la vélocité à l’accélération que vous entrez dans les cycles. S.M. : Il faut donc introduire la fonction monétaire avant de parler de cycle. B.L. : Avant de parler d’échange… S.M. : D’échange, oui. Et une fois que vous avez l’échange, vous avez des étapes du mouvement cyclique. B.L. : Eh bien, l’enchainement n’est pas si simple. Vous pouvez avoir un échange sans argent dans une économie de troc. S.M. : Oui. B.L. : Et alors vous n’avez pas d’unité comptable. S.M. : Mais dans une économie de troc vous n’avez pas d’argent. Vous avez les échanges. Il faut que vous ayez l’argent pour faciliter le mouvement qui peut être récurrent. B.L. : Oui. Si vous avez une économie de troc, vous voudrez peut-être obtenir quelque chose que vous aimez mieux que ce que vous possédez déjà et vous voudrez offrir ce que vous avez mais que vous n’aimez pas. Vous pensez que l’objet désiré vous sera plus utile. Et vous devez chercher à savoir qui sont les gens qui pourraient vouloir ce que vous avez. Si vous avez de l’argent, vous pouvez aller n’importe où et obtenir ce que vous voulez. Cela étend le processus d’échange. Mais cela le rend plus complexe aussi, si vous allez plus loin. E.dN. : L’une des choses dont nous nous sommes préoccupés depuis les années 1930 je pense c’est la suffisance de la demande et c’est pourquoi les gouvernements faisaient appel constamment aux budgets déficitaires pour soutenir la demande, faire fonctionner l’économie, et ainsi de suite. Et quand nous lisons Circulation Analysis, il est difficile de trouver la préoccupation concernant la demande. Est-ce que j’ai raison? La préoccupation touche plutôt les profits tirés de la production. Est-ce que la correction s’impose? B.L. : C’est ce qui fera augmenter la demande, n’est-ce pas?. E.dN. : Est-ce que vous pensez que l’offre crée sa propre demande, comme le dit la loi de Say… B.L. : Il est plus simple de se pencher sur le développement du processus. Si vous imaginez un losange de baseball et que vous distinguez les quatre points de référence, le marbre sera les débours de production des biens de consommation et des services, les débours de base. Le deuxième but sera les débours de surplus, où sont produits les moyens de production et les services nécessaires pour les moyens de production. Ces deux types de débours sont des sources de revenus. Et les débours de surplus mènent au troisième but, comme les débours de base mènent au premier but. 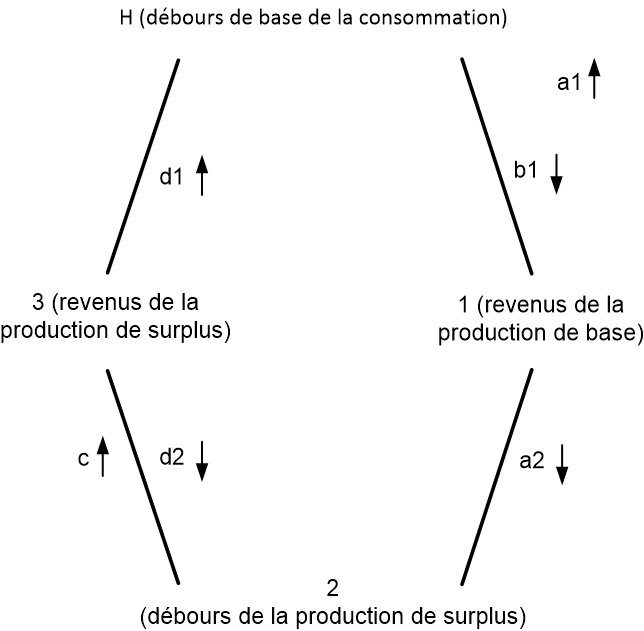
La pointe supérieure (H = Home plate, le marbre) représente les débours de base; les débours pour fournir les biens et services de consommation. Ces débours deviennent des revenus (b1 dans le diagramme), qui deviennent des dépenses de base, et le mouvement va dans deux directions (a1; a2 dans le diagramme). Une partie va vers les biens et services de base; celle-là va vers la partie de leurs revenus dépensée pour les biens et services de consommation. Et enfin le mouvement (a2) conduit vers les biens et services de surplus. Il y a des capitalistes également dans la production de base. Et d’où vient ce surplus? Il vient du fait que cet argent provient… non, nous ne sommes pas là encore. Ici (c; d1 dans le diagramme), les débours de surplus de base : les débours de surplus vont également aux biens et services de consommation pour les travailleurs et tous les autres… le niveau de vie (d1). E.dN. : et aussi les dépenses de consommation. B.L. : et une partie va aux revenus et dépenses de surplus (d2 dans le diagramme). E.dN. : Les revenus de surplus et les dépenses de surplus, n’est-ce pas? B.L. : Oui. E.dN. : Je ne sais pas si ma remarque est utile. B.L. : Il y a d’autres éléments à considérer. Vous avez un croisement, de la base au surplus (a1 dans le diagramme) et du surplus à la base (d1 dans le diagramme). Les travailleurs tirent leur niveau de vie (a1; d1 dans le diagramme) du niveau de base. Et ils donnent aux producteurs de base plus que ce que les producteurs de base dépensent en le versant à leurs travailleurs et à leurs sources. Tout cet argent vient du surplus. Vous avez donc une augmentation des prix dans les biens et services de consommation de base et cela constitue l’argent « capitaliste » à investir. E.dN : Est-ce que les prix augmentent… c’est votre phase d’expansion? B.L. : Oui. E.dN. : Est-ce que les prix augmentent dans le secteur de base parce qu’il y a une demande de biens mais qu’il n’y a pas d’autres biens? B.L. : Il y a une demande de biens mais il n’y a plus de biens et de services de consommation disponibles. E.dN. : Alors les prix montent. B.L. : Oui. Vous voyez, l’argent versé ici aux travailleurs pour les biens et services de surplus doit se refléter dans le niveau de vie et ce niveau de vie s’ajoute à tous les coûts qu’ont les producteurs de base. Alors il y a une augmentation des prix. Et cette augmentation des prix a pour fonction primaire d’augmenter leur investissement en capital. Il y a donc un élément de plus qui compense le croisement, n’est-ce pas? Outre le croisement du surplus vers la base (d1 dans le diagramme), il y a le croisement de la base vers le surplus (a2 dans le diagramme) et ces deux croisements doivent être égaux, sinon un circuit va l’emporter sur l’autre. S.M. : Est-ce que je peux répéter ce que j’ai compris de ce que vous venez d’énoncer? Le croisement est l’argent épargné, par exemple dans le circuit de base, les gens qui gagnent de l’argent dans le processus de production de base, ils touchent des salaires et il reste de l’argent au-delà de leur niveau de vie. B.L. : Ils obtiennent des profits et des intérêts. S.M. : Oui. Des profits et des intérêts. Il reste donc de l’argent une fois assuré le fonctionnement du ménage et le fonctionnement de l’entreprise. Il reste de l’argent. B.L. : Oui c’est cela. S.M. : Cet argent peut aller dans les débours de surplus. B.L. : Oui. S.M. : À partir des débours de surplus, il y a de l’argent qui est versé pour maintenir l’entreprise de fabrication des machines et de construction des usines et il y a … B.L. : Il s’agit d’un investissement de surplus n’est-ce pas? S.M. : Oui c’est ça. Il y a un investissement de surplus… mais… attendez une minute… de l’activité de surplus, c’est-à-dire des usines qui fabriquent des machines et des compagnies de construction qui construisent des usines, vous avez des revenus qui peuvent assurer le fonctionnement des usines et le fonctionnement de l’industrie de la construction. Mais il y a plus. Vous pouvez avoir l’argent qui paie les travailleurs pour leur permettre de vivre aussi bien que n’importe qui. Ce qui est déplacé vers le circuit de base à partir du circuit de surplus doit… E.dN. : … passer de la base… B.L. : du surplus à la base. Les salaires de tous les gens qui travaillent dans le circuit de surplus. E.dN. : Ok. Mais alors ne faut-il pas que le 45 % revienne? B.L. : Oui. Mais il va revenir par l’intermédiaire des producteurs du circuit de base. E.dN. : Qui veulent investir. B.L. : S’ils ne veulent pas investir, alors vous avez le centre de redistribution, n’est-ce-pas? Et ils mettent l’argent à la banque ou dans des assurances ou des obligations ou ce que vous voudrez et les gens là utilisent cet argent pour investir. E.dN. : Quelqu’un d’autre va emprunter et investir. S.M. : Alors quand vous décrivez la baisse proportionnelle du PIB que les différents pays dirigent vers les entreprises industrielles en expansion, vous signifiez aussi qu’il y a eu une prospérité qui représentait une hausse du niveau de vie des gens aussi, ou est-ce que les 45 % attribués au Japon ne permettrait pas au Japon de se trouver dans une situation équilibrée entre la base et le surplus. B.L. : C’est là que se présente une difficulté. Parce que toute expansion tient à des idées nouvelles… toute grande expansion. Et les idées nouvelles ne poussent pas dans les arbres. Il y a des idées qui peuvent être fertiles et vous pouvez répéter l’esquive plusieurs fois. Vous pouvez creuser des canaux et avoir des péniches, du transport, améliorer énormément vos services de transport. Et vous avez des moteurs à vapeur stationnaires, et faire fonctionner des usines, et ainsi de suite, là où vous n’avez pas de puissance hydraulique. Puis vous avez des locomotives qui tirent des trains, dont des trains de marchandises. Puis vous avez des moteurs à combustion interne et des automobiles et des autoroutes et ainsi de suite. L’évolution se poursuit inexorablement. Mais lorsque la seule perspective nouvelle concerne l’arrivée des ordinateurs, qu’allons-nous faire des aciéries? Et des chemins de fer? Et des automobiles? Et ainsi de suite… Nous sommes dans une situation inédite, une discontinuité. La fonction des cols blancs s’accroît, mais pas celle des cols bleus. Sauf dans la mesure où les ordinateurs exigent un certain niveau de fabrication. Il s’agit surtout d’avoir des gens très intelligents qui conçoivent des ordinateurs plus performants. Quand cette relâche se produit dans la phase de surplus, son expansion ralentit, et vous n’avez plus ce flux des débours de surplus vers les revenus de base. Cela signifie que les augmentations de prix doivent diminuer. Mais quand les augmentations de prix commencent à se contracter, elles ne le font pas partout également. Il y a des entreprises protégées, et elles ne disparaissent pas. Mais il y a aussi des entreprises plus vulnérables qui absorbent tout l’impact de la contraction des augmentations de prix et qui font faillite. Ensuite, c’est le groupe inférieur suivant qui quitte les affaires. Puis un autre, et un autre, et un autre, et on peut arrêter cette hémorrhagie dans la mesure où on peut persuader les gens protégés de partager. C’est là une idée très difficile à faire passer. Et si les gens refusent de partager, alors on se retrouve avec le socialisme. Le socialisme est au pouvoir en France. On me dit (j’ai de très bonnes sources) que Mitterrand a dû nationaliser les banques pour que les banques prêtent de l’argent non seulement à des gens qui pouvaient payer des taux d’intérêts très élevés mais aussi à la population en général. Autrement dit, pour mettre fin à l’économie à deux volets, un volet régi par l’offre et la demande et un volet des oligopoles où les syndicats sont très riches et très retranchés, où les gens d’affaires pouvaient se faire dire par les dirigeants syndicaux : « nous savons que vous contrôlez vos sources et vos marchés et que vous pouvez nous accorder une augmentation de 13 % de manière générale. Nous voulons 39 % et si vous refusez nous irons en grève ». Et les gens d’affaires réfléchissent et se disent : s’ils font la grève nous perdons nos revenus et les directeurs penseront que nous avons fait un mauvais travail. Cependant, il n’est pas difficile d’augmenter nos prix suffisamment pour accorder les 39 % demandés. Évidemment cela fait croître l’inflation; tout ce que nous devons faire, c’est de nous aligner sur la Réserve fédérale. Parce qu’un échec tel une grève importante dans une industrie majeure peut causer beaucoup de dommages, non seulement à cette industrie, mais à tout le pays. Les gens de la Réserve parlent d’accommodement; tant que vous avez un accommodement et que les affaires se poursuivent, l’inflation s’accroît. Et l’inflation s’accroît également dans la perspective post-keynésienne : l’inflation augmente dans la mesure où il n’y a pas assez d’épargne pour couvrir les prêts accordés par les banques, et alors vous avez un changement des prix qui entraîne une épargne involontaire. Comme les prix sont trop élevés, vous épargnez malgré vous. Et alors l’épargne involontaire d’ajoute à l’épargne volontaire, pour compenser le volume du crédit accordé. E.dN. : Alors une augmentation de l’argent et du crédit comme on dit entraîne une inflation. B.L. : Peut-être. On a découvert une règle lorsque la Banque d’Angleterre a mis fin à la convertibilité avec ses billets. En 1797, la Banque avait prêté de l’argent discrètement au gouvernement pendant les guerres napoléoniennes. La Banque a commencé à refuser l’échange pour de l’or des billets de cinq livres ou autres. Après un certain temps, il y a eu une faible inflation, qui ne nous inquièterait pas actuellement mais qui a paru très étrange dans l’Angleterre de cette fin du 18e siècle. Cela a donné lieu à des discussions qui ont filtré et alors un homme, je crois qu’il s’appelait Taunten, je ne suis pas certain, qui a écrit un pamphlet pour expliquer que le taux d’intérêt, la condition d’équilibre entre le crédit et l’argent tient au fait que le taux de profit attendu de l’investissement doit être égal au taux d’intérêt. S’il est plus bas, les gens vont emprunter librement parce que tout ce qu’ils empruntent est à leur avantage, et s’il est plus élevé, ils n’emprunteront pas assez pour continuer de fonctionner. C’est là une condition d’équilibre. Mais ce qu’il faut pour assurer cette condition d’équilibre, vous devez avoir une situation instable et cette situation instable se présente lorsque vous n’avez pas assez de gens disposés à prêter pour égaler le nombre de personnes qui veulent emprunter et si vous obtenez cet équilibre au bon endroit, vous êtes de nouveau en sécurité. Et cette idée a prévalu jusqu’après John Stewart Mill. Puis elle a été éclipsée et à la fin du siècle, vers la fin du 19e siècle, elle est redevenue dominante. Je cite l’ouvrage de Schumpeter, History of Economic Analysis, du moins je m’y réfère, sans utiliser les mots mêmes de ce livre. E.dN. : J’aimerais en savoir un peu plus sur l’expansion de base. Vous avez dit dans Circulation Analysis, si je comprends bien, que les entreprises et l’économie ont appris à gérer une expansion de surplus. B.L. : Tout le monde gagne de l’argent, n’est-ce pas? Vous n’avez pas besoin d’être fûté. Il faut simplement être là où l’argent coule. Mais quand l’expansion de surplus ralentit, vous avez différentes phases. Dans la première phase, le situation ne change pas considérablement. Puis on atteint un point où les gens marginaux dans le circuit de base commencent à sentir la pression. Il commence à y avoir des faillites et quand il y a suffisamment de faillites pour que les banques commencent à s’effondrer, alors vous avez une véritable dépression. Lorsque vous avez un effondrement, les gens ne savent plus où ils peuvent obtenir ce dont ils ont besoin pour maintenir leurs entreprises. Les circuits commerciaux sont perturbés. Les gens dont on obtenait des choses ne sont plus là et c’est pourquoi il a fallu tant de temps pour sortir de la dépression au début des années 1930. On en est sortis en fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. E.dN. : Nous devons donc trouver un moyen d’éviter ce genre de faillites? B.L. : Oui bien sûr! E.dN. : Mais il y aura… est-ce que vous affirmez qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait des pertes? Si les gens partageaient l’écart de prix de base, l’écart pourrait tout simplement être de zéro. B.L. : Vous avez raison. Mais vous devez enseigner aux gens que l’état stationnaire, ce n’est pas un malheur! L’état stationnaire ne procure pas le genre de profits que donne une expansion de surplus. Mais il assure le niveau de vie auquel vous êtes habitué. Parce que vous payez toujours pour ça! E.dN. : Et il fournit suffisamment d’emplois pour les gens? B.L. : Ça c’est un problème plus complexe. Par exemple, vous avez le nombre de personnes en cause. Et… E.dN. : Et les gens devraient se déplacer dans les industries dans une expansion de surplus. B.L. : Oui. Voilà. Et c’est très difficile à assurer. Mais les gens peuvent trouver un moyen. Pour vendre cette idée plus largement, vous devez avoir une machine à propagande considérable, par exemple promouvoir la vente d’obligations de guerre. Mais il n’est pas si évident de trouver le motif pour persuader les gens de vendre. Cela concerne les anciens mots d’ordre, comme l’optimisation des profits. C’est un peu grossier. Cela a du sens peut-être dans une expansion de surplus qui se déroule à grande vitesse, mais l’optimisation des profits passe par une des petites esquives les plus simples dans le capitalisme élémentaires, les maxima et les minima, et leur application à la courbe de vos revenus et à la réalisation de profits pour atteindre le point maximum, c’est-à-dire lorsque la courbe s’élève, puis commence à baisser. Et de façon très simple vous mettez vos dy/dz ou ds/dt à zéro et alors vous avez le plat tangent lorsque la courbe commence à baisser. C’est le lieu d’un maximum. Et vous savez lorsque vous parvenez là parce qu’après vous commencez à gagner moins d’argent. Mais l’application d’une idée mathématique au monde des affaires généralement, comme s’il s’agissait d’un précepte de la science économique, n’est pas quelque chose qui découle d’une analyse que je connaisse. Il y a des entreprises qui font le maximum, mais dans l’ensemble, dans toute industrie, il y a des entreprises très compétentes et des entreprises peu efficientes et ainsi de suite. La machinerie qu’elles utilise variera et ainsi de suite. S.M. : En ce qui concerne la transition que mentionne Eileen, du surplus où les gens commencent à aller vers leurs services de base et… B.L. : S’ils peuvent obtenir les emplois! S.M. : S’ils peuvent obtenir les emplois, cette transition dont vous parlez exigerait que les gens acceptent un emploi de vente massive. Mais pour reconnaître que nous sommes à cette étape, selon vous, ces processus productifs qui sont protégés envoient des signaux erronés… B.L. : Eh bien, ils ne sentent pas encore la piqûre, n’est-ce pas? Ils ne commencent pas à la sentir jusqu’à ce que les gens arrêtent d’acheter et que les ventes commencent à s’effondrer. Les inventaires commencent à augmenter. S.M. : Alors la lecture de ces signaux, les signaux vous indiqueraient de bons résultats, est bloquée par les situations protégées de même que celles qui échappent à l’unité économique dont nous parlons, échappent aux frontières nationales… B.L. : Oui. S.M. : Si elles échappent, les signaux ne seront pas lus. Alors comment pouvons-nous nous attendre que les gens… B.L. : Vous voulez parler de la science économique internationale? S.M. : Oui. B.L. : Ce n’est pas de cela que je parle. Vous devez commencer par le cas le plus simple et vous le rendez plus complexe en vous reportant à l’échelle internationale. S.M. : Ma question est : « Comment les gens savent-ils, comment peuvent-ils reconnaître que nous devrions entrer dans une phase de base en sortant d’une phase de surplus? » B.L. : Et bien, quand cela se produit et que se manifestent les signes, n’est-ce pas? La vente du surplus. On commence par offrir 300 $ à ceux qui achètent une voiture, n’est-ce pas? Et plus si vous achetez une aciérie. La Gazette de Montréal est enthousiaste ce matin à propos de la compagnie Bombardier qui bénéficie d’un vaste marché pour des tramways quelque part aux États-Unis. S.M. : Mais qu’est-ce que cela indique? B.L. : Cela indique un manque d’argent comptant au Canada, n’est-ce pas? Du moins l’enthousiasme. Je ne sais pas si Bombardier va laisser de l’argent au Canada, cependant. Je ne sais pas qui ils sont. Même si ce sont de bons Canadiens, ils peuvent aller s’installer aux Bermudes. E.dN. : Il faudra donc apprendre un nouveau type de comportement. B.L. : Vous avez raison. E.dN. : Pour assumer… B.L. : Oui. Et un changement de mentalité. E.dN. : Oui. B.L. : C’est là le point fondamental. Et cela veut dire qu’il faut écrire de manière à ne pas irriter les gens. Il est très difficile d’écrire sur l’économie sans affronter ce défi. E.dN. : L’une des choses qui est ressortie d’un entretien précédent concernant l’économie est la suggestion qu’il nous faut des économistes moraux. Cela ne semble pas très attrayant… B.L. : Bien, vous avez des fabricants d’automobile moraux qui vous expliquent qu’il ne faut pas appuyer en même temps sur les freins et l’accélérateur, et d’autres consignes pour la conduite et la protection de votre auto. E.dN. : Ils peuvent devenir très autoritaires à ce sujet. B.L. : Oui. Ils peuvent devenir très autoritaires parce nous savons qu’ils connaissent bien leur affaire. Et si vous rencontrez des économistes qui connaissent bien leur affaire, notamment des économistes qui parlent à des êtres humains, vous devez les motiver s’il y a quelque chose qu’ils doivent faire à votre avis. La motivation à leur transmettre est une motivation économique. Il ne peut s’agir d’une augmentation, dans certaines circonstances, l’expansion doit s’arrêter. E.dN. : Tout comme le profit est une motivation. B.L. : La question du profit est simple : si vous ne réalisez pas de profit, vous n’êtes plus en affaires. Mais il s’agit de profits énormes, n’est-ce pas? Ces profits énormes existent et permettent à ceux qui les reçoivent de connaître une expansion, ou de s’approprier une expansion. Sans profits, vous ne pouvez maintenir une expansion. Vous allez commencer à resserrer les opérations, à les interrompre. Et si les gens qui reçoivent ces profits les transmettent dans le secteur de la redistribution, alors à moins que quelqu’un soit disposé à les investir, l’économie va ralentir. E.dN. : Mais lorsque vous dites que l’économie concerne des êtres humains… B.L. : Je parle tout le temps des êtres humains! Il faut leur faire comprendre quelles sont les conséquences de leurs actions. E.dN. : Ils sont donc motivés par la compréhension. B.L. : Oui. S.M. : Y a-t-il une condition préalable… vous dites à un moment donné : une société d’amour et une société de gens qui se cherchent eux-mêmes. Vous ne vous attendez pas à une société d’amour. Vous dites : Une société de personnes informées. B.L. : C’est un minimum. E,dN. : Mais une fois que vous avez dit cela, qu’est-ce que vous voulez? B.L. : Vous pouvez penser à quelque chose de mieux. S.M. : Où est-ce que l’engagement à la recherche et au développement s’intègre dans ce circuit circulaire? B.L. : Surtout sur les débours de surplus. Mais aussi sur les débours de base dans la mesure où les gens améliorent leur équipement; par exemple en achetant des ordinateurs. S.M. : Et l’initiative. Où le gouvernement entre-t-il dans ce tableau? Que fait le gouvernement? Est-ce que l’économie se déploie de manière autonome? B.L. : C’est comme ça qu’a été conçue l’économie du laissez-faire. Que les politiciens ne se mêlent pas de l’économie et laissent les gens d’affaires mener seuls leurs affaires. S.M. : Ce n’est pas ce que… ? B.L. : Keynes a dit que si les gens d’affaires ne mènent pas seuls leurs affaires, il faut y remédier. C’est le seul argument. Je n’ai rien entendu d’autre. Une personne formée en politique n’est pas formée en gestion des affaires. Mais à mesure que se développent les économies… tout le développement en économie est venu de personnes qui travaillent dans le concret. Lorsque surviennent des situations complexes, vous avez des écrivains qui produisent des tracts et des professeurs d’économie et des questions disputées et ainsi de suite. E.dN. : Lorsqu’Adam Smith, pour parler d’économistes moraux, lorsqu’Adam Smith parle de sa main invisible, la notion selon laquelle si nous poursuivons nos propres intérêts, nous réaliserons le bien de la société. B.L. : Mais ils doivent savoir quels sont leurs intérêts! Vous devez éliminer l’égoïste qui ne cherche que ses propres intérêts. Il pense qu’il peut améliorer son sort, mais il détruit tout le reste. E.dN. : Alors Smith a tort? B.L. : Non. Nous parlons des intérêts véritables. Un escroc ne sert pas ses intérêts, ses véritables intérêts. E.dN. : Les véritables intérêts en économie sont liés à la connaissance du bon fonctionnement de l’économie. B.L. : Le bien commun, c’est une économie qui fonctionne! Tout comme en éducation le bien commun est un système éducatif qui fonctionne. E.dN. : Cela ne signifie pas nécessairement que la perception de Smith est fausse, dans la mesure où vous comprenez comment fonctionne l’économie. B.L. Ìl libérait les gens du mercantilisme, qui signifiait que seul le gouvernement avait l’initiative. E.dN. : Dans le cadre du mercantilisme, oui. B.L. : Et cela créait des fiefs. La Compagnie des Indes orientales, la Compagnie de la Baie d’Hudson, et ainsi de suite. Il y avait de grands débats au parlement au sujet du comportement de ces compagnies. Edmond Burke dénonçait la charte de ces compagnies au parlement anglais. Mais selon Schumpeter, Adam Smith représente une synthèse de la science économique de son époque. Il a tout rassemblé. Selon Lord Kaldor, il a accordé trop d’attention aux prix, aux prix nominaux, aux prix réels, et a raté l’ensemble de l’économie, les conditions pour que cela fonctionne. En conséquence, la macroéconomie est devenue importante après Keynes. Elle n’a plus grande importance maintenant. S.M. : Si je peux revenir à quelque chose que vous avez dit précédemment : pour envisager une autre facette de la manière dont le passage du circuit de surplus au circuit de base est contrecarré, vous avez parlé d’une part du processus de l’aide sociale. Vous avez mentionné également comment la guerre, et la guerre à la pauvreté et d’autres éléments semblables peuvent justifier… B.L. : Les lunches des écoliers. S.M. : Les budgets déficitaires et ainsi de suite. Nous ne recevons pas les avertissements, mais vous avez aussi décrit de manière très impressionnante comment dans l’histoire de l’expansion coloniale en Angleterre entre 1790 et 1870, il n’y a pas eu de changement des salaires, et vous avez avancé, au moins une fois je crois, que cela a été possible parce que la transition du circuit de surplus au circuit de base n’a pas été imposée à l’économie en raison de la possibilité de vendre aux colonies et de les endetter. B.L. : Vendre aux colonies et leur prêter l’argent pour payer. S.M. : Oui, et en retirer les intérêts et rendre les colonies dépendantes. B.L. : Et perturber l’économie anglaise puisque, lorsque cet argent de surplus circulait en Angleterre… après la Première Guerre mondiale, l’économie ne pouvait pas absorber tous les travailleurs. On taxait les gens qui possédaient des richesses venant de sources étrangères pour avoir l’argent nécessaire à l’assurance chômage. S.M. : Pensez-vous que si on avait mieux compris, on n’aurait pas eu recours à ce genre… B.L. : Ce n’était pas fourni! Ce n’était pas la faute des gens d’affaires, ce n’était pas la faute des économistes, ils n’avaient pas… S.M. : l’insight… B.L. : la perspective, n’est-ce pas? Il ne s’agit pas seulement d’un insight. Il s’agit d’accumulations d’insights. Il faut travailler sur cette question pendant des années pour en faire le tour. J’ai commencé à explorer cette question en 1930. J’avais produit un texte en 1944. J’ai consulté des économistes à divers endroits et ils m’ont dit : mais de quoi traitez-vous? Alors j’ai mis mon texte de côté pendant 32 ans. Puis j’ai entendu parler de Kalecki, un Polonais, qui était venu en Angleterre avant la Deuxième Guerre mondiale, qui s’était fait connaître chez les économistes de Cambridge en Angleterre, en particulier Joan Robinson, et qui a beaucoup contribué au fonctionnement de l’économie de guerre en Angleterre, parce que si vous êtes un planificateur socialiste, vous pouvez aider à planifier un effort de guerre également, et à planifier le financement de cet effort. Il a exprimé une remarque qui m’a frappé : « Les travailleurs dépensent ce qu’ils reçoivent; les capitalistes reçoivent ce qu’ils dépensent ». Cela cadrait très bien avec mon analyse. Et j’ai commencé à croire que mes réflexions étaient valables. S.M. : Vous parlez de quel moment? Les années 1940? B.L. : Non, non. J’ai découvert ce livre vers 1976. Il a été rédigé en 1971. Il s’agissait d’un recueil d’articles écrits en polonais et traduits en anglais, publiés par Cambridge University Press. Cette façon de parler des travailleurs et des capitalistes traduit une approche socialiste, une approche de théorie sociale, de l’économie. Elle ne fait pas appel à des idées économiques. S.M. : C’est étonnant. J’ai de la difficulté à voir comment des gens reçoivent ce qu’ils dépensent. B.L. : Mais d’où viennent les revenus de surplus? C’est le flux des investissements dans l’économie qui ne produit aucun bien, aucun service de consommation, et par conséquent ne peut être versé dans les prix des biens et services de consommation et par conséquent l’argent de surplus, l’argent à dépenser, maintient l’expansion! Pourquoi l’expansion se poursuit-elle? Parce que l’argent revient! À mesure qu’il est dépensé il revient! Et il revient sous forme de revenus de surplus. E.dN. : Est-ce que cela signifie que les capitalistes recueillent les revenus de surplus et les dépensent en les investissant? B.L. : Oui. Alors ces revenus continuent de revenir. Mais ils ne reviennent pas nécessairement aux individus. N’importe quel capitaliste peut perdre sa chemise! Mais c’est une personne dans la position d’un capitaliste qui peut recevoir cet argent. Il ne va pas à l’aide sociale, il ne va pas dans des salaires. S.M. : J’ai emprunté cette approche en espérant que nous parlerions des pays sous-développés dont vous parlez vers la fin de votre texte. Vous présentez un tableau très complexe des difficultés que doivent affronter les pays sous-développés engagés dans un processus d’industrialisation. Est-ce que je peux vous poser une question très générale pour que vous résumiez pour nous les problèmes des pays sous-développés? B.L. : Le principal problème tient au fait qu’il y a des gens très riches, qui vivent dans de belles maisons, avec des Cadillac à la porte et des murs élevés autour de leurs propriétés. Et il y a des gens à l’extérieur qui n’ont pas l’électricité, ni l’eau courante, et qui touchent tout au plus des revenus de subsistance. Et pourquoi cela? Parce que les gens riches n’investissent pas dans leur propre pays. Ils savent que ce serait un gaspillage, parce que leur pays n’a pas les infrastructures voulues. Il n’a pas les routes, il peut avoir des ressources naturelles, mais sans posséder l’équipement voulu pour les extraire, ou sans avoir le savoir-faire pour en tirer des revenus, et ainsi de suite. Ils sont réellement sous-développés. Et vous pouvez avoir un début de développement industriel dans un pays, habituellement réalisé par des gens de pays étrangers qui viennent exploiter les ressources. Et alors que certains habitants du pays sont prospères, cette richesse attire leurs concitoyens des campagnes qui préfèrent mourir de faim en ville qu’à la campagne. Il manque à un tel pays des professionnels, des écoles, et ainsi de suite. S.M. : Et des syndicats? B.L. : Il n’y a pas de syndicat, ou du moins pas de syndicat efficace. Et le gouvernement n’est pas efficace non plus. S.M. : Et ne comprend pas les enjeux… B.L. : Eh bien, il faut connaître beaucoup de choses à propos des autres pays pour réfléchir à ces choses. Vous devez être un vendeur très convaincant pour persuader les citoyens de ce pays qui ont de l’argent de l’investir dans leur pays. Ils ne voient pas d’espoir en ce sens. Ils ne sont pas formés! S.M. : Et les gens d’un tel pays n’ont pas la patience nécessaire pour passer à travers le processus. B.L. : Ils n’ont pas les idées! Et alors les multinationales arrivent et vous avez toutes ces émissions de télé doublées dans les différentes langues, et un certain nombre de stations et d’heures de télédiffusion. Vous avez Coca Cola qui vend ses produits à un taux extraordinaire, qui s’élève au niveau d’une classe supérieure dans le monde. Ce n’est pas désespéré. Dans la National Review, il y a un mois je pense, il y avait un article d’un économiste de Chicago… E.dN. : Friedman? B.L. : Ce que Friedman a fait au Chili. Pinochet avait lu Samuelson pendant des mois et avait conclu que ça ne fonctionnerait pas. S.M. : Pinochet qui avait chassé Allende du pouvoir. B.L. : Oui. C’était une junte. On l’a persuadé d’abord de réduire les impôts pour que les gens puissent investir, et de réduire l’inflation qui était de 1200 % à l’arrivée de Pinochet au pouvoir. Elle est maintenant de 12 %. Friedman a comparé ce changement à la résurrection de l’Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Il a pu le faire au Chili parce qu’il n’y avait qu’un gouvernement. Il n’y a pas un président qui a tous les pouvoirs, et la Réserve fédérale. Pinochet n’aurait pas pu faire cela au Chili si le taux d’intérêt avait été de 19 %. Une compagnie ordinaire qui gère l’offre et la demande ne peut pas payer des intérêts si élevés et avoir l’argent nécessaire pour mener ses affaires. Comme le disait Molina, le fameux moraliste espagnol : l’argent et l’outil du marchand. Vous pouvez acheter et vendre si vous avez l’argent et plus vous avez d’argent, plus vous pouvez acheter et vendre. Et si vous devez payer 19 % pour avoir l’argent, vous ne pouvez pas réaliser de profits qui vous permettent de vivre et de payer les intérêts. S.M. : Alors Allende ne pouvait pas réussir là où Pinochet a réussi parce qu’Allende n’avait pas le pouvoir dont Pinochet a pu bénéficier sur le reste de la société. B.L. : Je ne sais pas s’il avait les idées nécessaires non plus. S.M. : Je vois. Il faut donc avoir les bonnes idées et le pouvoir. B.L. : Comme disait Keynes : « Ce sont les idées à la longue qui mènent le monde ». C’est à la fin de The General Theory of Employment, Interest and Money. S.M.: Mais si on lit les reportages de toutes les souffrances subies par le peuple au Chili après le coup d’État, il fallait une affirmation violente du pouvoir. B.L. : Tout ce que je dis c’est que… cet article dans la National Review sur Pinochet et Friedman. Mais Friedman a emmené avec lui au Chili un certain nombre de ses gars brillants pour tout planifier. S.M. : Les Chicago Boys. B.L. : Oui. E.dN : Ce que je comprends dans ce que vous dites c’est qu’il n’est pas facile de savoir comment concrétiser le bien dans l’histoire… il faut avoir de bonnes notions, comme vous le disiez plus tôt. B.L. : Les mauvaises notions ne font qu’empirer les choses. Et c’est là un enjeu que néglige la liberté excessive. Pour concrétiser le bien, il faut savoir ce qu’est le bien. Le bien humain signifie beaucoup de choses. Voir le chapitre 2 de Pour une méthode en théologie. S.M. : Vous dites que l’on impute la faute à la cupidité, mais le principal fautif, c’est l’ignorance. Et après tout ce que vous avez lu, vous manifestez une confiance extraordinaire en l’intelligence, qui, en voyant comment fonctionnent les choses, sera portée à prendre les bonnes décisions, des décisions bonnes pour l’ensemble de la société. Il faut que les gens qui travaillent dans les grandes multinationales formulent d’excellents conseils pour que la croissance importante de ces compagnies se poursuive. B.L. : Ils peuvent y arriver grâce à des fusions, n’est-ce pas? Accroître leurs avoirs. S.M. : Oui. Mais alors qu’est-ce qui… B.L. : Il y a une caricature dans le New Yorker. La New York Merger Bank. S.M. : Mais ils peuvent embaucher les meilleurs cerveaux; pourquoi se plaint-on des opérations des multinationales? B.L. : Vous pouvez lire ce qu’écrit Pauline Kael au sujet de ce qui va mal dans le cinéma contemporain! Si les multinationales achètent studio après studio, elles mettent un bon publiciste en tête d’un de ces studios et il va produire des films très médiocres. S.M. : Alors vous dites qu’il ne s’agit pas d’ignorance, puisque ces gens veulent vraiment connaître les bonnes idées. Ils pourraient les avoir. B.L. : Non. Les gens ne savent pas ce que c’est que de vouloir des idées. J’hésiterais à demander à quelqu’un ce qu’est une idée. S.M. : Est-ce que je peux chercher à en savoir plus. B.L. : Une idée est le contenu d’une série élaborée d’insights, d’une série cumulative d’insights. S.M. : Et un processus explicatif, alors? B.L. : C’est quand vous avez un système explicatif, n’est-ce pas? Le système est le produit d’un développement cumulatif d’insights. S.M. : Ce que vous recherchez alors, c’est le développement d’un système. B.L. : Oui. Mais qu’est-ce qu’un système? Qu’entendons-nous par le mot système? Dans une pensée systématique, il n’y a pas de terme non défini. Comment savez-vous ce que signifie un terme? S.M. : À partir des termes eux-mêmes tels que vous les avez définis. B.L. : Et comment les définissez-vous? S.M. : En utilisant les termes en rapport avec les relations et les relations en rapport avec les termes. B.L. : Oui, c’est cela. Et en vérifiant à la fois les termes et les relations, n’est-ce pas? C’est un système fermé. Ce peut être un système ouvert comme la table périodique. E.dN. : Dans Circulation Analysis, vous parlez de la différence entre les lois classiques en science et les lois statistiques. Dans cet ouvrage, diriez-vous qu’il s’agit d’une explication classique? B.L. : Oui, mais il ne s’agit pas de prédiction, n’est-ce pas? E.dN. : Non. B.L. : Il ne s’agit pas de prédiction. Il s’agit de compréhension. Qu’est-ce que l’inflation? Qu’est-ce que le chômage? Est-ce que c’est quelque chose que vous connaissez à partir d’une analyse marginale? L’analyse marginale de la pénibilité du travail et de la vie facile des jours sans travail. Ou encore l’affirmation de Keynes, n’est-ce pas? Si vous voulez accroître l’emploi, créez de nouveaux postes. Et la manière la plus simple de créer des postes est d’accroître le nombre de fonctionnaires. La manière moins facile est d’établir davantage d’industries productives. P.P. (Philip Pocock) : Je me demande, quand vous mentionnez que l’état stationnaire n’est pas si mal, cela a de fortes résonances chez moi. J’étais récemment à Londres, à un séminaire de la London School of Economics. L’un des conférenciers était un tout jeune homme, Joseph Kennedy jr, le fils de Robert Kennedy. Il a mentionné qu’il était dans l’approvisionnement. Il a une petite entreprise qui approvisionne 200 000 personnes âgées et pauvres au Massachusetts, en huile à chauffage peu dispendieuse. Il achète l’huile, mais au lieu d’investir, au lieu de faire de gros profits, et d’investir en trouvant de nouvelles sources et ainsi de suite, il se contente d’obtenir un profit modeste et ne cherche pas à grossir davantage. Il veut continuer à approvisionner 200 000 personnes pauvres au Massachusetts et il aimerait que d’autres créent de petites compagnies semblables pour approvisionner des personnes pauvres et âgées dans d’autres États. C’était son argument. Les critiques disaient, et je me demande si vous considérez cela comme un cliché, qu’en affaires on ne peut rester stationnaire. Il faut monter ou descendre. Comment vous voyez cela… B.L. : À certains moments vous pouvez monter mais à d’autres moments vous ne pouvez pas. L’idée est que l’ensemble de l’économie peut continuer de croître indéfiniment. Cela présuppose une création constante de nouvelles idées pratiques qui sont sources d’innovations. Quand cette source tarit, vous avez une contraction. L’ampleur de la contraction dépend de la résilience de l’économie, de la compréhension qu’elle a des causes de la contraction et des limites de ses pouvoirs d’agir sur la contraction. Il vous faut d’autres idées nouvelles. Si vous ne voulez pas subir une contraction ou une dépression, vous pouvez vous contenter d’un état stationnaire, qui est préférable aux misères associées à une dépression. Il y a un homme à la New School for Social Research, un certain Lowe, un Allemand, qui conçoit une économie qui ne connaîtrait aucune expansion, sauf si la main-d’œuvre s’accroît. Il éviterait le chômage en contrôlant l’expansion de l’économie. Ce n’est pas une idée nouvelle, mais je n’irais pas si loin. J’admets que si vous ne pouvez pas faire mieux qu’un état stationnaire, ok. Mais si vous pouvez faire mieux, en évitant les misères du capitalisme sauvage, alors avancer n’est pas mauvais, n’est-ce pas? E.dN. : J’aimerais ouvrir une période de questions, à la suite d’une question de Eric Poznansky. P.P. : Si vous étiez Premier Ministre du Canada, et que vous alliez au Sommet économique en Europe, en faisant appel à votre théorie, quelle serait votre réponse à… B.L. : J’aimerais avoir cent ans pour leur apprendre mes idées. P.P. : Nous parlons donc de conversion dans l’enseignement et la formation, et de tout le processus d’Insight et de Method. B.L. : Mais c’est un long processus, n’est-ce pas? Si mes idées sont acceptées dans cent ans, je serai satisfait. Le processus de la transformation de la mentalité des gens… il y a tellement de clichés en faveur du capitalisme libéral que vous butez sans cesse sur des obstacles. P.P. : Ce n’est pas ce dont vous parlez délibérément quand vous traitez du bien humain, n’est-ce pas? B.L. : Le bien humain c’est l’ensemble du bien humain. Nous parlons ici simplement de l’économie. P.P. : Mais même de liberté au sens de l’économie. B.L. : Le libéralisme et la liberté sont deux choses différentes. P.P. : Oui, mais je veux dire que je saisis ce concept même dans une organisation individuelle, et non seulement sur une échelle globale. C.T. (Charlotte Tansey) : Pourquoi votre modèle concerne-t-il plutôt l’équilibre que le déséquilibre? B.L. : Il concerne également le déséquilibre. L’équilibre est l’opposé. Si le modèle concerne l’un, il concerne les deux. C.T. : Mais ne diriez-vous pas que dans tout ce qui est créatif, il y a forcément un certain déséquilibre. B.L. : Oui. Le capitalisme est un état permanent de déséquilibre simplement parce qu’il change. Il y a un changement pour le meilleur et un changement pour le pire. C.T. : Il me semble, si nous nous référons à la biologie, que l’équilibre est synonyme de mort. B.L. : Cette image peut servir à justifier cette théorie économique. Mais si l’on pense au processus de croissance… le processus de développement, normalement, atteint un certain niveau puis recule. Oui, Roberta. R.M. (Roberta Machnik) : Dans le livre « Food First »… que je n’ai pas lu, mais que vous utilisez comme référence dans ce texte… est-ce que ce livre porte sur l’économie comme théorie, ou s’agit-il simplement d’information… B.L. : Surtout d’information. Les auteurs ont voyagé partout dans le monde. Il y avait un certain nombre de rédacteurs qui produisaient des rapports, et ainsi de suite. Et ils ont conclu qu’il n’y a aucun pays qui en soi n’est pas capable de nourrir ses citoyens. Mais les citoyens ne possèdent pas tous l’ensemble des ressources. Et il y a des facteurs puissants qui empêchent les gens d’obtenir les ressources. J’ai entendu dire qu’à certains endroits dans les Caraïbes si une personne vient enseigner aux gens la façon d’élever des poulets, elle se fait assassiner. On ne veut pas que les gens aient trop de pouvoir. P.P. : Vous parlez d’une terrible paranoïa. B.L. : C’est un rapport dont j’ai entendu parler. Un rapport produit par une religieuse qui s’est rendue dans un de ces pays-là. P.P. : Est-ce que cette situation s’apparente à ce qui se passait en Chine, dans la République populaire de Chine, où, récemment, on forçait un pilote expérimenté ou un médecin à travailler comme serveur dans un restaurant, pour qu’ils apprennent… B.L. : On voulait qu’ils acquièrent le grand avantage de la mentalité prolétaire. F.L. : Vous avez un certain nombre d’équations qui constituent un modèle mathématique de l’économie. Comment envisageriez-vous une validation de ce modèle en y insérant des données pour voir si elles ont valeur de prédiction. B.L. : Il ne s’agit pas d’un modèle de prédiction. Les symboles sont généraux simplement parce qu’il ne s’agit pas des données de notre propre pays. Mme De Neeve a publié un livre associé à mes théories, mais elle s’est intéressée aux pays d’Europe de l’Est où le surplus est recueilli par les gouvernements et utilisé pour l’exécution du plan quinquennal. Et ce qui reste une fois que le gouvernement a recueilli ce qu’il considère comme le surplus est versé dans la vie du pays et du peuple. Ainsi vous avez une division claire de ces deux comptes. Or vous pouvez calculer, d’après nos sources d’information, le C et le I de Keynes, la consommation et l’investissement. Et d’après le PIB cette proportion peut être attribuée à l’investissement, mais il s’agit là d’une approximation lointaine. Quelle est la taille des investissements? Vous avez affaire simplement à des indices. Si vous lisez des critiques au sujet des défauts des indices, et si vous n’avez pas trop confiance, vous ne pourrez rien prouver à partir de ces calculs. Mais ce que je propose c’est d’aider les gens à comprendre ce qui se passe dans la mesure où nous pouvons le percevoir. Si les gens savaient ce qui cause l’inflation et ce qui cause le chômage, et tout le reste, ca qui cause une récession et une dépression et un effondrement et ainsi de suite… ils conviendraient que mes affirmations ont du sens. Et avec le temps, peut-être, ils formeraient des groupes et laisseraient les choses se développer tranquillement, autrement, ce serait comme du fabianisme, n’est-ce pas? R. : Vous ne recommandez pas un état stationnaire, ou est-ce une condition permanente? B.L. : Non. Il s’agit d’une phase. Là où Keynes recommandait des déficits budgétaires, parce que l’économie était dans un creux, et connaissait un niveau de chômage dont on n’avait pas espoir de sortir, selon les lois ordinaires de l’économie, ou selon les vues conventionnelles des dépenses que pouvait faire le gouvernement. Cette suggestion était une idée nouvelle. Ils étaient d’accord, en temps de guerre, vous devez avoir des déficits budgétaires, soit en émettant des obligations, soit en recourant à des mesures fiscales. Mais un état stationnaire et un état où chaque personne peut jouir de son niveau de vie normal et où l’économie fonctionne bien. Cet état continue de se reproduire, comme dans la France du 18e siècle qui était et est demeurée un pays riche sur le plan agricole. P.P. : Ne faut-il pas une théorie à ce sujet? Si je comprends bien, et je n’ai pas lu vos œuvres économique attentivement, ne faut-il pas avoir une notion du contenu avant de pouvoir faire des prédictions? B.L. : Oui! P.P. : Et ne faut-il pas que ce soit associé également à une théorie du système social? B.L. : Pour disposer d’un modèle entièrement prédictif, certainement. Mais allons-nous disposer de deux systèmes et chercher à les combiner? La théorie sociale n’est pas trop rigoureuse habituellement. P.P. : Ce que je me demande, c’est : à quoi sert cette description? B.L. : À l’intelligence. Les gens sont mystifiés par l’état de l’économie actuellement. Et cette mystification est un obstacle parce qu’on ne peut leur vendre quoi que ce soit. Ils ne savent pas! Il faut commencer par leur faire comprendre quelque chose. P.P. : Mais si cela est tellement abstrait. B.L. : La compréhension n’est pas abstraite. La compréhension est compréhension… P.P. : du genre que vous avez décrit. Et le très très concret qui se profile derrière ma question. Je ne sais pas si cela a du sens. B.L. : Oui, bien sûr! Mais la mathématisation de l’économie, si les post-keynésiens ont raison dans leur rejet de l’économie néoclassique, constitue un rejet de la théorie abstraite en économie. E.dN. : Je ne sais pas si cela correspond à votre question, mais je me demande : L’économie peut-elle être comprise eh dehors d’un contexte politique? B.L. : Vous devez avoir un contexte politique pour savoir comment l’appliquer. Savoir ce que vous pouvez faire dans cette situation. E.dN. : La situation comporte des limites politiques, ou des contraintes politiques ou des contraintes sociales. B.L. : Oui, bien sûr. E.dN. : Mais en ce sens, est-ce que l’économie est autonome? B.L. : Elle n’est pas autonome. Mais il faut la comprendre en elle-même avant que l’on puisse la comprendre en conjonction avec quelque chose d’autre. Dans ce cas, vous devez recourir à deux types de compréhension systématique. Et il vous faut une manière de les relier. Ce moyen, c’est une théorie des systèmes. S.M. : Alors la théorie s’appliquerait autant au système soviétique qu’au système canadien… B.L. : Non, pas du tout. La théorie des systèmes est présentée dans le dernier article du professeur Eichner, A Guide to Post-Keynesian Economics. Dans le contexte de la théorie des systèmes, une économie est l’ensemble des institutions sociales qui répondent aux besoins matériels des humains, de la société. Puisque vous disposez des institutions sociales qui cadrent avec les autres choses. C’est ce qui a été développé par la cybernétique, aux États-Unis. Bertalanffy, un Hongrois, et Weiner ont œuvré en cybernétique. P.P. : C. West Churchman a popularisé quelque peu la théorie des systèmes. M.F. (Maddie Ferrin) : Je me demande… vous dites que les multinationales se préoccupent de leur légitimation politique. Est-ce parce que cela leur rendrait la vie beaucoup plus facile? B.L. : Cela dépend… il y a plusieurs perspectives concernant les multinationales. Notamment celle de Barnett et Muller, qui affirment que les multinationales pensent pouvoir diriger l’économie partout dans le monde, qu’elles seules possèdent les instruments, les techniques et le savoir-faire pour diriger l’économie mondiale. Et que les petites économies démocratiques et impérialistes doivent maintenant fermer boutique et laisser les multinationales prendre le pouvoir. Cependant, à certains moments les multinationales ont un autre discours, et se plaignent que les gouvernements ne les aident pas suffisamment. Par exemple, l’industrie japonaise est appelée aux États-Unis Japan Incorporated. Tout cela va ensemble. M.F. : Comme des rencontres du cabinet avec des compagnies? B.L. : Oui. Et dans l’industrie allemande, les travailleurs sont parmi les directeurs. S.M. : N’y a-t-il pas une exigence que, quel que soit l’éventail des opérations atteint par les compagnies… s’il s’agit d’une envergure mondiale, alors il doit y avoir des contrôles mondiaux pour protéger les intérêts de ces sociétés en général; ou, en somme, y a-t-il une exigence parallèle au sujet de ce que ces unités économiques deviennent, ne devrait-il pas y avoir une unité politique qui accroisse son autorité en conséquence? B.L. : Actuellement, ce que je vois, c’est qu’aucun pays ne veut interférer avec les opérations de ses multinationales. Il ferait concurrence alors à sa propre balance commerciale. Aucun pays ne va donc affronter durement ses propres multinationales. De toute façon, les gouvernements ne sont pas équipés habituellement pour cela. J’ai lu que la formation donnée aux comptables dans les universités est environ cinq ans en avance sur la formation offerte aux gens des Services internes du revenu. Une personne du ministère de l’Impôt sur le revenu à Ottawa m’a dit qu’un individu modeste ne peut pas obtenir grand-chose, mais que si un homme peut déchiffrer ce que font les grandes compagnies, les grandes compagnies vont lui offrir deux fois le salaire que nous lui payons. S.M. : Voudriez-vous parler un peu plus de la possibilité d’expansion. En somme, vous dites : « aucun gouvernement ne va faire… » B.L. : Actuellement. S.M. : Oui. Mais cela uniquement parce que les gens ne comprennent pas les enjeux. B.L. : C’est tout à fait vrai. Mais je me contente modestement d’offrir une à une des idées pour l’économie. Il faut saisir ces idées individuelles avant de pouvoir établir des liens entre de nombreuses idées. Il est très difficile d’obtenir des données sur ces relations sauf peut-être pour dans vingt, trente, quarante, cinquante ou soixante ans. Et cela exige une formidable équipe de chercheurs pour vous fournir les données, et ainsi de suite. Vous devez donner… c’était là la base du mercantilisme, ils donnaient leurs motifs! Et c’est là la base du « laissez-faire », ils donnaient leurs motifs. Et si le « laissez-faire » ne fonctionne pas, alors il nous faut présenter un autre ensemble de motifs et le diffuser. P.P. : Ma question n’est pas très sérieuse, mais elle m’inquiète. Le professeur Postan, qui enseignait l’histoire de l’économie à Cambridge, a écrit un article il y a quinze ans probablement et ce qu’il disait me préoccupe particulièrement maintenant, en rapport avec ce que vous avez dit au sujet des 100 ans de formation pour M. Trudeau et al.. Postan a cherché à réfléchir à l’efficacité du conseil de M. Kaldor et de tous les autres conseillers économiques offert au gouvernement britannique, depuis la dernière guerre jusqu’à il y a dix ans. Il avait décidé que le seul nom collectif pour désigner les économistes était le fléau des économistes. Comment réagissez-vous à un tel énoncé? B.L. : C’est un énoncé humoristique, mais Leontief, dans son discours présidentiel devant l’American Economics Association, a dit à peu près la même chose, vous savez. Il a dit… P.P. : Si je peux me permettre de vous interrompre. Il a dit, dans un énoncé plus sérieux, qu’aujourd’hui aux États-Unis tout ce qu’il faut pour publier un article dans une revue économique très prestigieuse, c’est une connaissance de l’algèbre du niveau de l’école secondaire, plus la maîtrise d’une dizaine de mots. Il poursuivait en disant que personne ne devrait être autorisé à écrire un article sur l’économie du logement sans posséder une expérience existentielle de la construction et de l’exploitation d’une maison, de son rôle et de son but, etc. Le jury du prix Nobel semble penser que les économistes n’ont pas si bien travaillé. En considérant que le premier prix Nobel d’économie a été accordé à un psychologue, un informaticien, Herbert E. Simon, je me demande si la science économique n’en est pas encore à un stade primitif. B.L. : Je m’intéresse énormément aux post-keynésiens, qui m’aident beaucoup. Mais deux des économistes qui ont contribué à cet ouvrage dans une université américaine, je crois, ont été exclus de tout enseignement au deuxième cycle il y a un an. Et je peux comprendre. C’est comme si on persuadait des professeurs d’anglais que le dix-septième comte d’Oxford avait écrit l’œuvre de Shakespeare. Cela reviendrait à abandonner le capital intellectuel qu’ils ont mis un demi-siècle à acquérir! Ce sont là des misères de la vie. P.P. : Cela toucherait des intérêts personnels. B.L. : On estimerait bien sûr qu’il serait honteux de ruiner les esprits de ces étudiants de deuxième cycle, en leur transmettant quelque chose qu’ils n’ont pas compris. S.M. : Est-ce que je peux revenir à la question qu’a posée Charlotte Tansey un peu plus tôt? Dans le croisement, en rapport avec l’équilibre, dans votre texte, vous parlez d’un léger déséquilibre. Quand un léger déséquilibre devient-il critique? B.L. : Lorsqu.il est cumulatif. S.M. : Pouvez-vous… B.L. : Autrement dit, si cela veut dire qu’il y a une transition d’un circuit de surplus à un circuit de base, en raison d’un croisement à ce moment-là, n’est-ce pas? Et il y a une transition dans l’autre sens par la suite, alors nous avons un équilibre relativement stable. Un équilibre est stable lorsqu’il est cumulatif. Il se dégrade constamment. S.M. : C’est la situation d’un moteur qui accélère sans arrêt. B.L. : C’est le même ordre d’idées. C’est cumulatif. Ça s’ajoute. Mais ce n’est pas la seule condition d’équilibre. Il y a toutes sortes de conditions d’équilibre. Dans une phase d’expansion, si vous voulez que l’expansion se poursuive, vous avez une condition d’équilibre, c’est-à-dire que les revenus d’investissements antérieurs doivent être réinvestis et que de nouvelles sommes d’argent doivent être investies pour maintenir le taux d’expansion. Et lorsque vous faites cela, le surplus commence à cesser d’être un surplus et à tout le moins l’expansion s’arrête. De même, l’expansion de base, c’est ce qu’il faut… plus cela dure longtemps, plus cela devient difficile. S.M. : Est-ce que ce sont les idées ou l’argent qui s’arrêtent lorsque cesse le stade de surplus? Autrement dit… B.L. : Il peut y avoir des adaptations, n’est-ce pas? Mais c’est celle-là qui est inhérente. Vous pouvez constater que cela arrive tous les dix ans, ou à l’autres intervalles, vous pouvez avoir des phases d’expansion de surplus, l’une après l’autre, le développement de l’énergie : l’énergie hydraulique, la vapeur, le pétrole, l’électricité. P.P. : Si l’on relie la théorie à la réalité pratique une fois de plus, dans la situation économique mondiale actuelle, pensez-vous que nous sommes dans une situation différente maintenant qu’au cours des trente dernières années? B.L. : Les problèmes se sont beaucoup aggravés. Nous avons une inflation et un taux de chômage qui augmente, et les post-keynésiens attribuent ces phénomènes aux remèdes proposés par les néoclassiques. Ils n’étaient pas d’accord. Le réglage de l’économie… relever les taux d’intérêt réduit l’investissement; réduire l’investissement rehausse le chômage. P.P. : Ça n’a pas réglé le déficit de Reagan cependant. B.L. : Reagan veut également un réarmement. Cela exclut l’investissement et fait augmenter le taux d’intérêt, en partie parce que Reagan devra emprunter pour son réarmement. En 1934, le premier ministre de l’Angleterre faisait campagne pour être réélu. Il savait que les Allemands se réarmaient, mais il ne voulait pas parler de réarmement dans la campagne électorale parce qu’il savait que les Travaillistes gagneraient l’élection et ne feraient rien pour le réarmement. Du moins, c’était son opinion. Et c’est comme cela que vous vous retrouvez dans une situation irrationnelle dans les affaires humaines, n’est-ce pas? L.M. : Est-ce que l’économie de guerre est la seule possible? Je pense au rapport d’Iron Mountain que j’ai lu dans les années 1970, où un groupe de personnes aux États-Unis, des experts, ont discuté de la possibilité d’un autre type d’économie pour les États-Unis et ont conclu que le seul type d’économie qui pouvait fonctionner aux États-Unis était l’économie de guerre. Est-ce cela l’irrationnel social dont vous parlez. B.L. : Non. Il s’agit simplement de budgets déficitaires. L.M. : Cela revient au même. Keynes n’a pas proposé le recours aux budgets déficitaires comme remède universel pour les écroulements des économies. Il proposait un tel recours pour les moments où une économie se trouvait piégée. Là où le nombre de chômeurs était très élevé et où seul un financement gouvernemental pouvait accroître le nombre de gens ayant un emploi. Mais si vous généralisez et appliquez cet expédient à la santé et à l’éducation, et à toutes les mesures bénéfiques pour la population auxquelles nous pouvons penser, et à l’armée des personnes qui administrent toutes ces mesures, alors nous ne sommes plus dans la logique de Keynes. Au Canada nous avons la pension de la sécurité de la vieillesse et seul le certificat de naissance sert à prouver l’admissibilité, c’est-à-dire l’atteinte du seuil de soixante-cinq ans. Il n’y a pas non plus une armée de personnes qui établissent des chèques. Cela se fait par des moyens informatiques. Je suppose que qu’il y a un mécanisme pour mettre ces chèques dans des enveloppes. Le service des postes s’occupe du reste, et les banques. L’administration des pensions est relativement peu coûteuse. E.dN. : Je pense qu’il est temps de vous dire « merci ». B.L. : Je vous remercie beaucoup de votre attention. 1 Il s’agit de Les voies d’une théologie méthodique. Écrits théologiques choisis, sous la direction de Louis Roy et Pierrot Lambert, ouvrage publié chez Bellarmin. 2 Il s’agit de Caring About Meaning. Patterns in the Life of Bernard Lonergan, entrevues réalisées en 1981 et 1982 par Charlotte Tansey, Carhleen Going et Pierrot Lambert, Thomas More Institute Papers 82.
|